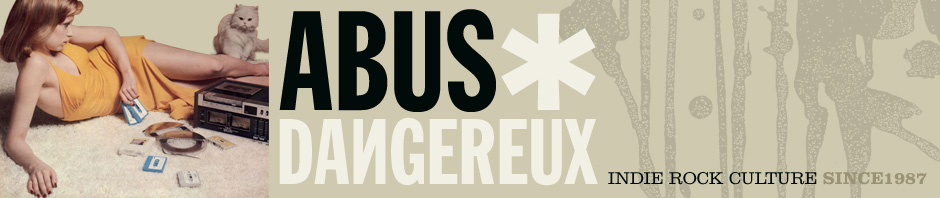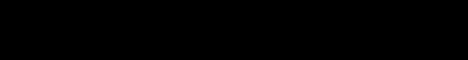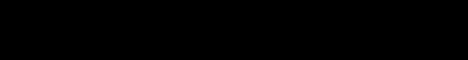(suite de l’interview paru dans le n°122)
Drowning by numbers
Si vous étiez abonnés aux Inrocks, au temps où le mensuel jouait son rôle de défricheur et de baromètre de la cause pop, vous devriez être emballés par 49 Swimming Pools.
Emmanuel Tellier semble avoir trouvé les compagnons de route idéaux pour rendre aussi bien hommage à la fraîcheur des Pale Fountains qu’à la préciosité des Cardinals, tout en y injectant une mélancolie toute personnelle. Après un premier album sans fioriture enregistré en trois semaines, le groupe nous offre aujourd’hui « The violent life and death of Tim Lester Zimbo » qui se décline en deux disques de sept titres aux mélodies évidentes et aux arrangements soignés dont la pertinence sera toujours aussi évidente dans dix ans, voire vingt. Cet emballement est confirmé par les propos d’Emmanuel qui, après de nombreuses expériences éditoriales et musicales plus ou moins gratifiantes, n’a rien perdu de sa passion pour la musique avec un grand M.
« A notebook at random » tourne autour de cette constatation que tout amoureux du rock passé un certain âge redoute : « What happened to your mysteries, fantasies, ecstasies ? they die… » Est-ce que c’est ce qui vous a poussé à créer 49 Swimming Pools ?
Oui, il y a un peu de ça. En tout cas la vie du groupe est d’autant plus intense qu’il y a cette peur, au fond, comme chez n’importe qui voulant bien l’admettre, de voir l’envie, le fantasme, le désir peu à peu disparaître, avec l’âge, ou l’expérience qui s’accumule. Nous avons dépassé la quarantaine, et nous avons déjà pas mal de musique derrière nous. Mais au lieu de nous avoir apaisés, ou rassasiés, cette expérience passée nous met dans un état d’urgence encore plus vital et précieux que si on n’avait jamais rien fait. Chaque disque est comme le premier. Et on se dit à chaque fois que ça pourrait être le dernier. Justement parce qu’on ne veut jamais s’entendre dire « qu’avez-vous fait de vos fantasmes ? » Alors on essaye de les vivre pleinement. Dès qu’on a un moment, on se retrouve et on joue. Même quand on n’est pas tous les quatre, la musique est partout dans nos vies: c’est une obsession, un besoin. Le fait d’avoir notre propre studio, en Touraine, est une chance fantastique. Cela contribue à nous permettre de faire notre musique dans une totale indépendance, en ne devant rien à personne. Le plus grand luxe qui soit !
Quelle est la principale évolution que vous pointeriez entre le début du groupe et maintenant ?
La confiance en nous, entre les quatre membres du groupe ! Pour le premier album, elle était déjà là, mais on avait fait ce disque de manière très intuitive, sans réfléchir, surtout Fabien et moi au départ. Avec le deuxième album, cette confiance est devenue absolue: je peux apporter une chanson à mes camarades et aller faire un tour, ou partir en écrire d’autres, je sais qu’elle sera entre de très bonnes mains, comme s’ils l’avaient écrites eux-mêmes. Ils vont la comprendre tout de suite, en tirer le meilleur parti possible. Ce disque a été comme un grand collage de tous nos apports. Ma grande fierté est l’équilibre que nous avons trouvé entre une mise en scène assez éloquente, la recherche d’une puissance, d’un impact, et la préservation d’une certaine fragilité. Il est beaucoup plus produit que le premier, mais en même temps, je ne crois pas qu’on soit tombés dans l’emphase. Peut être parce que nous enregistrons assez vite par goût de l’avancée rapide : parce qu’on se fait une confiance totale, parce qu’on parle la même langue…
Qui est ce fameux Tim Lester Zimbo qui meurt sous les balles à Mexico ?
C’est un personnage qu’on a inventé à peu près au milieu de l’enregistrement, comme une façon de nous stimuler et qui a donné une certaine couleur, un certain état d’esprit à nos sessions. Nous avions beaucoup de titres en chantier, on savait qu’on se dirigeait vers un disque assez long, assez épique, alors on a commencé à blaguer autour de l’idée d’un disque concept, en hommage à un grand homme dont l’histoire aurait été oubliée de tous. J’ai inventé ce nom, et on s’est mis à parler de Tim, de sa vie, et mine de rien, ça a donné du corps à nos conversations musicales. On s’est mis à se raconter les détails supposés de sa vie imaginaire : celle d’un homme né aux Pays-Bas d’un père éthiopien, qui part vivre aux Etats-Unis, fréquente Abraham Lincoln et milite pour la fin de la ségrégation raciale. On savait que c’était juste un jeu rhétorique, mais mine de rien, on en parlait souvent, et ce personnage s’est mis à nous accompagner. Il a apporté par moments une forme de gravité – un peu inconsciemment. Il aurait vraiment pu exister !
Ce nouvel album est présenté sous forme de deux mini albums distincts, alors qu’il n’y a pas de fracture acoustique/électrique ou pop/électro sur la longueur…
C’est vrai, mais nous, on s’est dit qu’écouter 7 titres d’un bloc, puis faire une pause, était une assez jolie idée… Les 14 titres d’un coup, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu indigeste… En tout cas, nous trouvions intéressant d’inviter l’auditeur à une respiration après une trentaine de minutes. Et puis l’objet doucle-cd est beau; ça a compté aussi dans le choix… Deux fois 7 ? Parce que 7 est un chiffre qui est partout dans ma vie. Je suis né le 7 juin 1967. Et 7 fois 7 égale… ?
« The crazy carousel » est il la traduction d’une certaine déception éprouvée en vous frottant avec la réalité de l’Amérique qui nous a fait rêver par ses chansons et ses films (et continue malgré tout) ?
Absolument. Et surtout, dans la chanson, la déception pour ceux qui ont voulu y émigrer (ou continuent à le souhaiter en 2011) et se prennent la réalité de plein fouet par la suite. L’eldorado a fonctionné pendant des décennies, pour des millions d’individus, mais tout le monde n’y a toutefois pas trouvé le bonheur. Tous les grands rêves ont leurs orphelins, leurs laissés-pour-compte.
On a l’impression (particulièrement dans « The crazy carousel »), de trouver chez vous le même esprit que chez les Flaming Lips qui racontent des choses incroyablement tristes tout en lançant des confettis au public Si vous ne trouvez pas cette comparaison complètement erronée, pouvez-vous nous expliquer d’où vient cette sorte de schizophrénie ?
Elle n’est pas du tout erronée, bien au contraire ! Je pense que globalement, sans vouloir paraître trop sombre, la société des hommes est souvent assez cruelle et terrible, et que seul un nombre très restreint d’humains a droit à une vie vraiment décente, stimulante, libre, nourrissante. Je pense aussi que les relations amoureuses sont souvent complexes, frustrantes, intellectuellement et émotionnellement assez dures. Et donc que le bonheur collectif comme le bonheur à deux sont des quêtes très éprouvantes. Alors il y a (sans trop de lourdeurs j’espère) des éclats de cette noirceur dans nos textes… Mais il y a aussi de la musique, des harmonies, des mélanges de sons qui nous viennent en permanence -de par notre éducation pop-rock, nos goûts, notre patrimoine sonore- plutôt du côté du soleil, de la joie, d’une recherche de beauté. Donc s’il y a schizophrénie, c’est là qu’elle naît : à cet estuaire où se croisent deux flots, des mots souvent assez sombres et l’envie d’une musique la plus lumineuse possible. J’adore quand ce contraste fonctionne (je pense à Automatic Love et Summer is coming), même si j’aime bien aussi par moment échapper à cette logique, et par exemple foncer dans un truc plus premier degré, comme A Notebook at random ou You’re too sentimental.
Vous appelez une orchestration sur disque qui n’est pas simple à trimbaler sur scène alors que vous n’avez pas les moyens d’un Neil Hannon de se faire accompagner par un orchestre ? Qu’est ce qui vous pousse à aller aussi loin ?
En fait, on pourrait aller encore plus loin ! J’ai plutôt l’impression qu’on reste assez mesurés, justement parce qu’on sait qu’on se sera jamais trente sur scène… Mais si on pouvait, ouh là…
Que vous apportent les projections en concert ?
Elles servent surtout à deux choses : tenter d’ouvrir au maximum l’esprit des gens, leur envoyer des sortes de stimuli visuels pour leur faire oublier qu’ils sont dans une salle de concert, les aider à se détacher autant que possible du cadre concret ; et ensuite également, nous alléger, nous, de ce qui peut être un poids, le regard fixe du spectateur. Il n’y a aucun problème à être regardé, ça fait partie du jeu. Mais si on peut, grâce au film, devenir un point de focalisation visuelle parmi plusieurs autres (et non plus le seul « truc » à regarder), et donc nous fondre un peu parmi les images, les éclairages, alors c’est vraiment parfait. On cherche à trouver une espèce de relation physique qui ne soit ni celle de l’écoute du disque à la maison, ni celle du concert classique, un état intermédiaire, un peu comme une rêverie. Le spectateur est dans la salle, le groupe est dans la salle, mais avec cette musique et ces images projetées par dessus le groupe, il y a comme une bulle qui nous emporte tous, et nous met sur un pied d’égalité. L’idée, c’est que ce soit la musique qui se retrouve mise en vedette, et pas ceux qui la jouent.
Cathimini
« The violent life and death of Tim Lester Zimbo » CD (Elap Music/Differ Ant)
http://49swimmingpools.blogspot.com