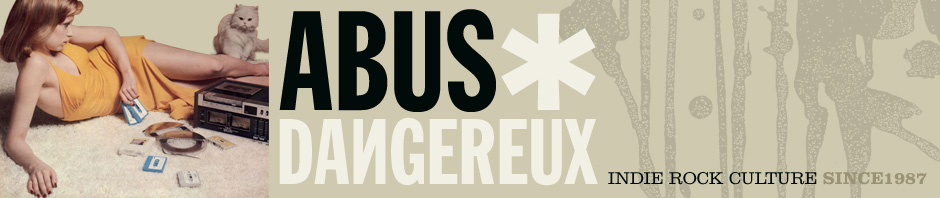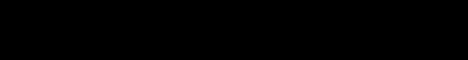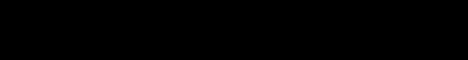AVEC OU SANS PLUMES
Il y a cinq ans, j’avais été touchée par la pudeur et la sincérité de « On concrete » porté par un duo folk éclairé par la magie d’arrangements audacieux qu’on aurait aimé voir touchés par la même reconnaissance que The Do.
Aujourd’hui Pollyanna est un groupe pop, qui cohabite sous le chapeau d’Isabelle Casier avec quelques autres projets montés au grès des rencontres et des festivals qu’elle écume, seule ou accompagnée de ses Fines Feathers. Car la solitude n’est pas le fort de cette jeune parisienne qui aussitôt « seule » s’est acoquinée avec un contre bassiste issu du free jazz, un batteur/percussionniste de l’école Thomas Belhom et une section de cordes féminine pour repartir du bon pied. Suite à un très joli EP mis en avant par les Ballades sonores au printemps dernier, Pollyanna vient de sortir un album tout en nuances et en guitares chez Vicious Circle. Invitation au voyage appuyé par une pochette fort à propo, « The Mainland » nous fait traverser des états d’âmes troublés pour nous déposer sur la rive de la libération. C’est pourquoi, il semblait indispensable de ne pas en rester là et de rencontrer le capitaine Isabelle Casier qui est à l’origine de tout cela.
Pollyanna est devenu un projet solo. Est-ce que de se retrouver seule aux manettes a été un soulagement ou un fardeau ?
Un fardeau, certainement pas. Un soulagement, ce n’est peut-être pas très gentil pour mon ex-acolyte ! Pollyanna avait de toute façon commencé comme un projet solo, avant d’être un duo pendant plusieurs années. Il s’agit donc d’une révolution au sens propre du terme. Et notre violoncelliste, Léa, a toujours été là, avant, pendant et après le duo, au moins en studio. Ceci dit, on avance beaucoup plus vite quand on est seul à décider, surtout quand on a peu de moyens. Avant, j’évitais les concerts seule, or je me rends compte que ceux-ci sont nécessaires si je veux jouer souvent et voyager. Et puis cette solitude est très relative, puisque j’ai fait plein de rencontres et je n’ai jamais joué avec autant de gens. D’ailleurs, je ne définirais pas Pollyanna comme un projet solo, mais plus comme un groupe informel. Si nous étions riches et célèbres, vous nous verriez toujours à plusieurs !
Tu es prolifique (30 chansons environ en 2 ans). Comment te vient l’inspiration ?
Tu trouves ça prolifique ? Je trouve que j’écris assez peu. C’est un processus lent et pas forcément facile. De plus, un drame personnel a bloqué mon écriture pendant plus d’un an. Ensuite, c’est revenu d’un coup, comme une grosse colère. Quant à dire ce qui m’inspire… C’est assez banal… Les relations humaines en général, intimes ou collectives, la quête de soi. Je parle de moi mais pas toujours: j’écoute les autres aussi. J’essaie de m’attacher à ces sentiments qu’on n’exprime pas forcément facilement. J’essaie de trouver un langage pour le doute, les peurs, les contradictions. Ecrire en Anglais, qui est une langue onirique pour moi, et utiliser la musique, qui est un art volontiers plus viscéral que cérébral, c’est idéal. Alors j’ai toujours des dizaines d’idées de chansons qui traînent. Le plus dur, c’est de les finir. Construire un ensemble cohérent à partir d’une image, d’un bout de texte, d’un riff de guitare trouvé par hasard… c’est vraiment long et fastidieux.
Tu as ouvert ton champs d’action à des influences plus power pop. Est-ce une évolution naturelle ou l’expression libérée d’une envie de « swinguer » que tu refreinais avant ?
Ni l’un ni l’autre : je crois que j’ai toujours été comme ça. J’écris à la guitare acoustique mais mon premier groupe, à Marseille, était entièrement rock et électrique. On avait fait la première partie de Sleater Keaney, Diabologum… Mes chansons étaient les mêmes, j’essayais d’écrire des choses tristes et belles. Jouer sans batteur m’a manqué pendant toutes ces années (dans le duo, nous étions tous les deux guitaristes de formation). La batterie est sans doute mon instrument préféré, après la voix. Sinon, je suis une piètre folkeuse, au fond : j’écoute beaucoup de trucs bruyants. Et pas mal de musiques traditionnelles. C’est de là que vient le côté acoustique, mais mal compris si on s’imagine que j’écoute du Dylan à longueur de journée. Disons que j’aime les musiques tripales, qu’elles soient douces ou pas.
Je ne comprends pas pourquoi les gens ont ces catégories de pensées : quelqu’un comme PJ Harvey, qui a une image très électrique, joue pourtant beaucoup de guitare acoustique sur ses disques, et sur le dernier elle nous a même noyés sous l’autoharp, un comble! Les choses sont donc plus mélangées qu’on le dit. J’étais à Memphis en février dernier, pour une grande convention folk, où il était assez clair pour tout le monde que je n’étais pas si folk que ça. Des gens m’ont même dit « rien qu’à la façon dont tu attaques les cordes, on sent que tu viens du rock ». Cela m’a fait plaisir. Mais j’adore la folk aussi, notez-bien… Enfin, on a le droit de faire plusieurs trucs à la fois, non?
Peux-tu nous parler de « Old Rockers » qui est assez atypique dans ton répertoire ?
Pas si atypique que ça, donc. J’ai eu l’idée de cette chanson en voyant une affiche de Iron Maiden dans le métro… Les vieux rockers n’en finissent plus de faire des come-backs. A l’image du reste de la société, qui vieillit. Finalement, la jeunesse ne veut pas changer de camp, et c’est étouffant pour les générations qui tentent de se faire une place. J’ai un peu suivi le discours des sociologues là-dessus, notamment un mec comme Louis Chauvelle. Et voilà, j’avais ma chanson. Comme d’hab’, il y a du jus de crâne mais j’ai essayé de faire un truc simple et rigolo. Pour la musique, je suis partie sur un riff blues-rock très basique, très Led Zep (que j’adore!). En pensant aussi à Canned Heat, surtout pour la ligne de chant. Jean-Mi, mon batteur, s’est lancé spontanément dans un plan qu’il dit tenir des batteurs Motown (la classe). A l’arrivée, on me dit que ça fait penser à PJ Harvey. CQFD.
Tu mènes deux projets de frond. Qu’est ce qui te fait penser qu’un titre est plutôt pour Pollyanna et un autre pour ton groupe « jazz » comme tu le dis ?
Quand le duo a splitté, j’en ai profité pour reprendre contact avec un batteur de jazz que j’adorais, Abdesselem Gherbi. Je n’étais pas sûre que ça l’intéresse, ni de ce que l’on allait faire ensemble. J’ai tout de suite conçu ça comme un side project pour me sentir à l’aise. Après deux répètes il est apparu évident qu’il fallait trouver un bassiste. J’ai branché le seul contrebassiste que je connaissais et ce n’était pas facile, parce que j’ai toujours peur que mes chansons ennuient des types comme eux, très érudits et virtuoses. Mais ce contrebassiste, François, vient du free jazz tout en étant fan des Cramps… C’était tentant. On a donc monté un trio, joué des nouvelles compos et réarrangé des anciennes. Notre couleur plutôt country-blues change de mes habitudes pop-rock.
Parallèlement, j’ai continué à jouer en solo et en duo avec ma violoncelliste. Lors d’un concert à Lille, j’ai rencontré Jean-Michel, aujourd’hui mon autre batteur, et on a aussi eu envie de s’associer. C’était une formidable rencontre : on a passé des week-ends entiers à jouer, parler et boire du vin. On a cherché des sons (enfin, surtout lui), passant par exemple des heures à jeter des cailloux sur une tôle pour trouver ceux qui faisaient le plus beau bruit. Bref : un travail bien différent du trio. Et j’avais, du coup, un nouveau groupe !
C’était une évidence que je voulais faire tous ces projets à la fois. J’avais du temps, des chansons, et je ne me suis pas posée la question de savoir comment j’allais articuler tout ça. Aujourd’hui je trouve que les deux formations se complètent bien. Il y a donc Pollyanna et Pollyanna and The Fine Feathers. Cela me permet de jouer plus souvent, de toucher un plus large public ou de lasser moins vite mes potes qui viennent me voir en concert. Quant à choisir quelles chansons jouer avec qui… C’est un peu de l’improvisation, mais disons que globalement je garde mes ballades un peu bluesy pour les Fine Feathers. Et mes trucs plus pop pour Pollyanna “nature”, qui est aussi plus sombre.
Tu ressens le besoin de jouer en groupe(s). Que t’amènent les collaborations des autres musiciens ?
Presque tout! Une chanson bien écrite, c’est essentiel, et en même temps ce n’est qu’un début. Il reste à trouver la couleur musicale, le bon tempo, la bonne intention générale… Cela prend du temps et peut modifier mon interprétation assez profondément, même quand je la joue seule. J’ai toujours en tête les parties des autres, même quand ils ne sont pas là. J’essaie de les intégrer à mon jeu de guitare et surtout cela m’aide à nuancer mon chant. D’ailleurs, s’il y a bien un effet assez spectaculaire du jeu en groupe, c’est de sentir à quel point cela m’a libérée à la voix. J’espère que cela s’entend sur le disque, mais la sensation est très claire pour moi. Ensuite, les autres amènent leurs influences avec eux, leur culture classique par exemple, et cela enrichit considérablement le son. Pour prendre une analogie culinaire, c’est un peu la différence entre une fève de cacao et un fondant au chocolat…
Tu tournes régulièrement à l’étranger. Comment fais-tu ? Qu’est-ce que cela t’apporte ?
Ce sont la plupart du temps des échanges de dates entre groupes. A force de tourner, on finit par avoir son réseau d’amis, de musiciens et de lieux. J’ai aussi un label à Brême qui m’aide à trouver des dates là-bas, et m’a permis de jouer dans une belle salle classique avec un quatuor à cordes et dans un festival. Pourtant, sauf exception, je n’ai pas accès à des “grosses” scènes, type premières parties. Sinon, jouer à l’étranger est pour moi assez naturel, déjà parce que je ne considère pas Pollyanna comme de la musique spécialement française. D’ailleurs, nous avons une altiste à Bristol et un violoniste à Hanovre… A la limite, nous sommes donc un groupe européen, ce qui a beaucoup plus de sens pour moi, même si ce genre d’idée n’est plus très à la mode. Il se trouve, en plus, que l’Europe est une obsession sous-jacente dans la plupart de mes textes, même si c’est très, très camouflé. J’ai longtemps étudié l’histoire, ça marque. Et j’ai grandi dans le Nord et le nord-est de la France, au croisement entre la France, l’Angleterre, le Bénélux et l’Allemagne.
Bref: j’écris mes chansons pour les faire voyager. L’Anglais, vaguement compris partout, pour moi déconnecté de tout terroir, me semble tout indiqué pour ce genre d’exercice. En plus, c’est une langue qui sonne bien. Et ses racines, entre les mondes germanique et latin, mélangées à tout le gloubi-boulga anglo-saxon dont nous sommes baignés depuis 1945, contiennent un imaginaire qui me convient tout à fait.
Enfin, confronter ses chansons à des publics différents est très enrichissant: c’est amusant de constater ce que perçoivent les gens en fonction de l’endroit où ils vivent. Et cela rend plus confiant, plus fort face à un public. Enfin, j’espère…
Tu t’occupes de beaucoup de choses toi-même en dehors de l’artistique. Comment vois-tu l’évolution de l’artiste indépendant dans ce monde de la musique en pleine mutation ?
Bien que je sois de moins en moins seule, il faut bien mettre la main à la pâte! Nous sommes très nombreux dans cette situation. Depuis deux ans, je me suis attachée à bien m’entourer artistiquement. Nous avons mis au point plusieurs formules live, de 1 à 6 sur scène, pour être le plus flexible possible. Je travaille avec French Toast à Paris, Vicious Circle à Bordeaux et Songs&Whispers, en Allemagne, qui organise des tournées roboratives. Et surtout, j’ai un éditeur, Melmax, qui me permet enfin de fonctionner d’une façon un peu plus formelle. Ceci dit : je ne gagne toujours pas d’argent avec ma musique. Et je continue de faire énormément de démarches seule.
Je suis un peu le chemin de mes amis étrangers, qui poussent la logique d’autoproduction jusqu’à un niveau impressionnant. J’en connais qui jouent régulièrement dans des salles de 2000 personnes et qui n’ont toujours pas vraiment de maison de disques. Aux USA, les musiciens ne parlent même plus de trouver un label. Ou de devenir riches. Ils font avec la situation économique que l’on sait, très pragmatiques. En France on me demande toujours plein de noms pour mettre dans les dossiers de subs, pour prouver qu’on a « un entourage », mais cela me semble obsolète. Et ce que je trouve dommage, c’est qu’à l’arrivée il est plus valorisant d’avoir un quelqu’un d’installé qui a misé 45000 euros sur toi, même si tu n’as jamais joué que devant tes chats, plutôt que d’avoir booké tout seul 300 dates dans 8 pays. Alors qu’il me semble que plus que jamais, les carrières se construisent d’abord sur le terrain. C’est ensuite que les labels sont utiles, pour amplifier tout ce travail. Mais il faut garder à l’esprit que c’est un long chemin et, comme dit une de mes copines américaines : « il n’y a pas de Magic Poney qui va descendre du ciel pour te transformer en star ».
Cathimini
« The Mainland » CD / LP (Vicious Circle/Differ-Ant)